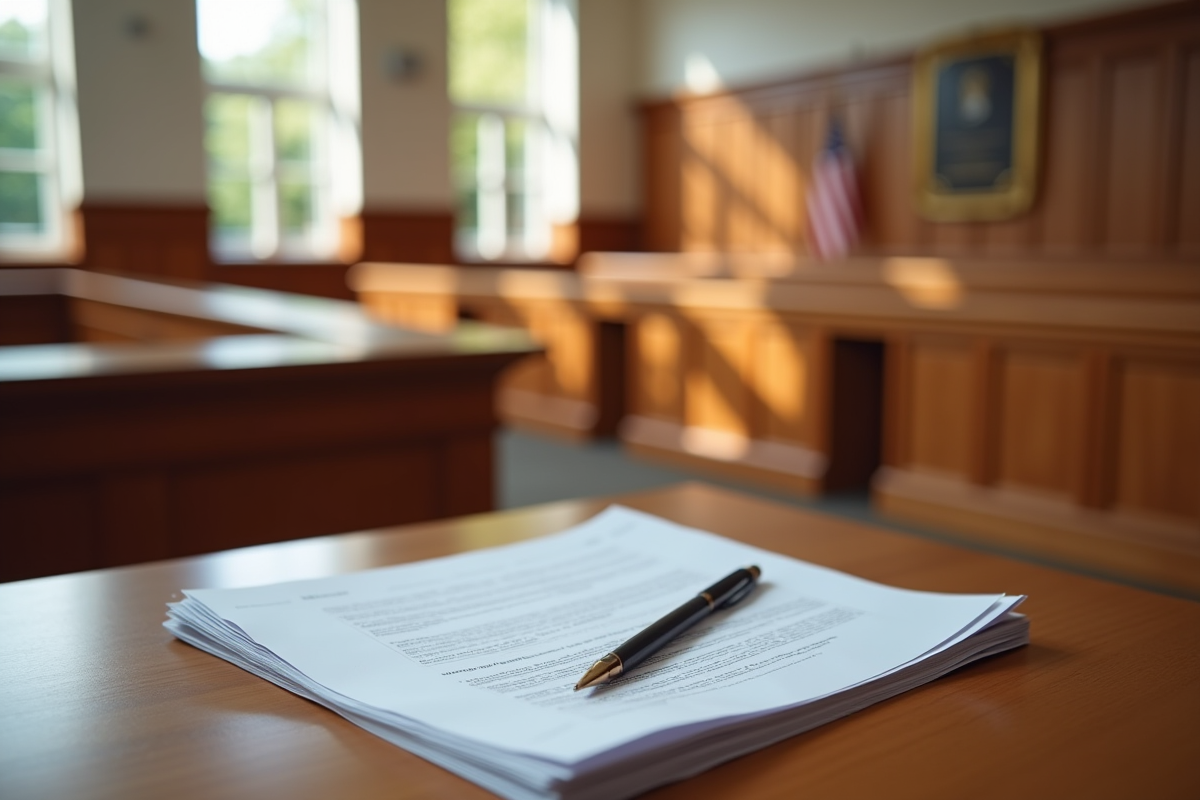L’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de préserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Depuis la réforme du 23 mars 2019, la représentation par avocat devient obligatoire devant le tribunal judiciaire pour toute procédure initiée sur ce fondement, sauf exceptions précises.
Cette évolution introduit des conséquences immédiates pour les parties, notamment en matière de litiges sur les vices cachés. La frontière entre accès à la preuve et protection des droits de la défense se redessine, impactant stratégie procédurale et accès au juge.
La réforme judiciaire du 23 mars 2019 : quels enjeux pour l’article 145 du Code de procédure civile ?
Depuis le 23 mars 2019, l’article 145 CPC a pris une dimension nouvelle. Loin de n’être qu’un simple outil de préservation de la preuve, il s’inscrit désormais dans une logique de transformation profonde du code de procédure civile. Les règles ont changé, et le tribunal judiciaire se trouve au cœur de cette réorganisation. Désormais, la représentation obligatoire par avocat s’impose, fermant la porte aux démarches isolées des justiciables non accompagnés. Le barreau de Paris, parmi d’autres, doit accompagner cette mutation et s’adapter à la nouvelle donne.
Le juge doit aujourd’hui composer avec une redistribution des cartes en matière de compétence territoriale. Les débats sont concentrés devant le tribunal judiciaire, limitant la multiplicité des juridictions compétentes. Cela resserre les marges de manœuvre pour les affaires relevant de l’article 145. Les avocats, à Paris comme ailleurs, ajustent leurs stratégies à cette recentralisation, qui tend à uniformiser la pratique des mesures d’instruction in futurum.
La cour d’appel et la cour de cassation sont désormais saisies plus fréquemment pour trancher des points de procédure liés à l’article 145 CPC. Ce contrôle renforcé, voulu pour harmoniser la pratique, modifie l’équilibre entre les parties et impose une vigilance constante sur la forme des demandes. Les professionnels du droit notent une montée en technicité du contentieux préventif, où le code de l’organisation judiciaire et la jurisprudence récente s’entrecroisent à chaque étape.
L’idée de justice et de recours prend ainsi une teinte nouvelle, portée par une transformation décisive des équilibres procéduraux. La réforme ne se contente pas de modifier le code de procédure : elle façonne également le rôle du juge et la manière dont les droits de la défense sont protégés.
Article 145 CPC : ce qui change concrètement pour les droits et obligations des parties
Les nouvelles règles qui encadrent l’article 145 CPC ont bouleversé les réflexes habituels en matière de contentieux préventif. Dès lors qu’il y a un problème de preuve à craindre, chaque partie peut saisir le juge pour obtenir une mesure d’instruction in futurum. Cela peut prendre la forme d’une expertise judiciaire, d’un constat dressé par un huissier de justice ou de l’obtention de documents spécifiques. Mais la rigueur s’est accentuée : il faut démontrer clairement le risque de dépérissement ou de disparition de la preuve. Le juge ne se contente plus d’allégations vagues.
Pour présenter de manière synthétique les différents outils à disposition, voici les principaux mécanismes sur lesquels les parties peuvent compter :
- Mesure d’instruction in futurum : déclenchée si un risque réel de perte de preuve est établi.
- Procédure sur requête : réservée aux situations où l’urgence ou la menace de dissimulation est manifeste.
- Référé : impose un débat contradictoire, chaque partie pouvant faire valoir ses arguments.
La jurisprudence affine, au fil du temps, la définition juridique de l’article 145 CPC. Les dérives vers la collecte généralisée ou exploratoire de preuves sont systématiquement sanctionnées. Les juges exigent aujourd’hui une justification solide, un encadrement strict, et s’assurent que chaque initiative reste proportionnée. Les parties, quant à elles, doivent composer avec un cadre clair, où chaque démarche se justifie et se contrôle.
Dans quels cas la représentation par avocat devient-elle incontournable après la réforme ?
Depuis mars 2019, la place de l’avocat devant le tribunal judiciaire s’est affirmée, notamment pour toute demande fondée sur l’article 145 CPC. Les justiciables sont confrontés à de nouveaux seuils de compétence et à des exigences procédurales qui rendent l’intervention d’un professionnel du droit difficilement contournable.
Pour éclairer la diversité des situations, voici les principaux cas dans lesquels l’assistance d’un avocat s’impose désormais :
- Devant le tribunal judiciaire, un avocat doit représenter les parties sauf exceptions prévues par le code de procédure civile.
- En référé ou sur requête, la présence d’un avocat conditionne la recevabilité de la demande dès lors que le litige porte sur plus de 10 000 euros ou implique des aspects techniques.
- Devant la cour d’appel et la cour de cassation, la procédure exige l’intervention d’un avocat spécialisé.
Les professionnels du droit deviennent un rempart contre les abus, mais aussi un gage de loyauté dans le déroulement des procédures. Les sociétés doivent s’appuyer sur l’expertise d’un avocat en droit des sociétés pour sécuriser leur stratégie, éviter la nullité d’actes ou la perte d’éléments de preuve décisifs. Cette évolution vise à clarifier l’accès au juge et à garantir un environnement juridique plus sûr pour tous.
Litiges liés aux vices cachés : comprendre l’impact des nouvelles règles sur la recherche de preuve
L’application de l’article 145 CPC au contentieux des vices cachés se fait désormais sous haute surveillance. Le juge doit trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la preuve et celle de préserver le secret des affaires ou le droit à la vie privée. Les demandes de mesure d’instruction in futurum se heurtent ainsi à des exigences renforcées : la partie qui sollicite une expertise ou l’accès à des documents doit présenter des éléments précis, pendant que la défense invoque fréquemment la convention de sauvegarde des droits de l’homme pour limiter l’intrusion.
Dans les dossiers d’immobilier ou de baux commerciaux, on observe un durcissement des ordonnances. Les juges réclament davantage de précision sur la nature du vice caché suspecté et sur le besoin d’accéder à certaines pièces, pour éviter tout excès dans l’investigation. Les avocats, quant à eux, jouent un double rôle : ils structurent la demande tout en s’assurant que les libertés fondamentales sont respectées.
Voici comment se traduit concrètement cette évolution dans les litiges sur les vices cachés :
- L’expertise judiciaire et l’intervention de l’huissier de justice ne se font plus automatiquement : chaque demande doit être justifiée et proportionnée à la situation.
- Le secret des affaires et la sauvegarde des droits prennent une place centrale dans l’argumentation, le tribunal judiciaire les examine avec attention.
Face à la multiplication des litiges en matière de garantie des vices cachés ou de concurrence déloyale, la procédure s’est affinée. Désormais, chaque partie doit avancer avec prudence : la recherche de la vérité ne doit plus se faire au détriment de la protection des intérêts privés. L’équilibre est fragile, mais il redéfinit le paysage du procès civil, et son avenir s’écrira sous le signe de cette vigilance renouvelée.